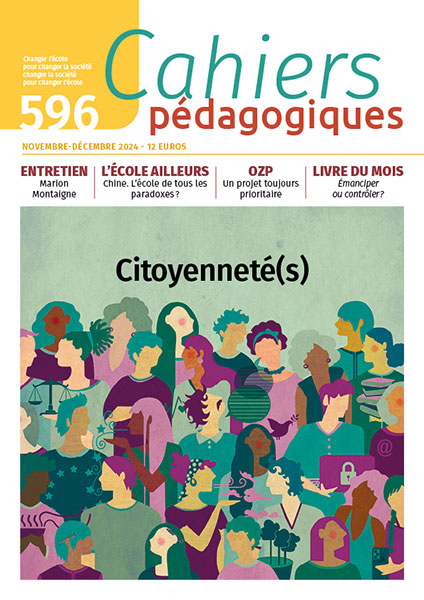Lectures : autour de la Citoyenneté (Cahiers pédagogiques n°596)
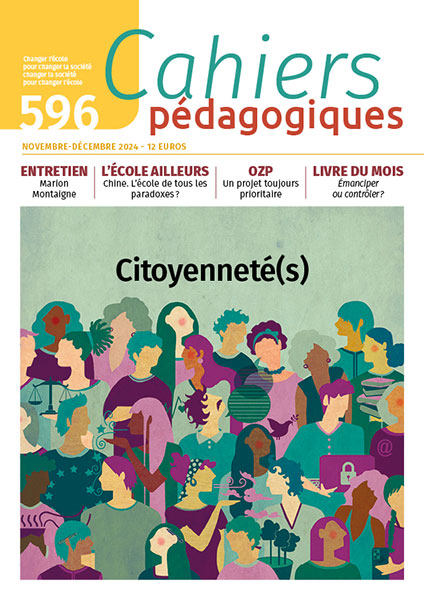
Lecture des Cahiers Pédagogiques, et plus particulier du numéro 2024/7, n°596, numéro intitulé Citoyennetés
Ci-dessous, quelques éléments (croisés) tirés de ma lecture des articles
Éduquer aux citoyennetés, au civisme ou aux civilités ?
Camille Roelens & Aurélie Zwang, p. 17
Respecter l’ordre ou faire valoir ses droits ?
Aline Vieira De Sousa & Julio César Pereira Leite, p. 20-22
Peut-on décréter la citoyenneté ?
Titouan Lahitte, p. 22-24
L’individualisme démocratique contre le citoyen républicain ?
Camille Roelens, p. 28 à 30.
Entrer en recherche en éducation
Chloé Mimar, p. 33
Entre posture et culture civique
François Augier, p. 36-37
Questionnement de fond : « quel homme ou quelle femme engagée dans la cité l’école contribue-t-elle à former par ses savoirs, ses valeurs, ses enseignements et ses pratiques ? »
Idéal de l’école républicaine » tel qu’il se constitue contre le Second Empire (1852-1870) » = « un objet conceptuel complexe qui « prend pour objectif le développement du bienêtre général de la population au moyen de l’instruction, la doctrine proprement républicaine de l’École a ceci de particulier qu’elle se base sur l’idée d’un droit inconditionnel à l’éducation, en vertu de l’humanité à laquelle nous appartenons tous. » « idée maitresse » de « l’autonomie de l’individu », qui « passe par l’apprentissage de l’esprit critique ».
Eclairage de la dictature brésilienne et de son concept de citoyenneté réglementée (« seuls ceux qui occupaient certaines catégories professionnelles reconnues par l’État étaient considérés comme des citoyens. Les employés sous un régime informel, les chômeurs ou les élèves, par exemple, ne bénéficiaient pas du statut et des droits de la citoyenneté. ») et questionnement fondamental autour de l’objectif de l’éducation : L’éducation doit-elle former des citoyens autonomes (et épanouis) ou obéissants ?
Janvier 2024, Emmanuel Macron parle de réarmement civique. Terme entraînant de nombreuses réactions. Conception de la citoyenneté que l’on peut qualifier de « citoyenneté rituelle », une approche qui « constitue un paradigme normatif qui consiste à comprendre l’ordre républicain comme le résultat d’une intégration réussie de valeurs enseignées par l’école. Celles-ci, n’ayant pas vocation à être discutées, se transmettent par des rites qui façonnent le comportement du citoyen ».
« Lieu commun du discours public contemporain en France » : l’opposition entre l’individualisme démocratique et le citoyen républicain, deux conceptions contemporaines des démocraties modernes. La « distinction entre les deux idéaux » est une « question de priorités démocratiques. »
- « La démocratie peut être entendue, au sens politique, comme une méthode pour pourvoir les postes de pouvoir, où l’obtention d’un vote majoritaire remplace d’autres logiques, comme celle de la naissance dans les monarchies et aristocraties. Est démocratique alors ce qui respecte cette logique. »
- « La démocratie peut aussi être entendue dans un sens à la fois plus social et sociétal, c’est-à-dire une manière de faire signe vers ce que serait la société idéale pour que les individus, dans toute leur diversité, puissent chacun vivre leurs quêtes du bien-être en coexistant pacifiquement, en ne connaissant de limite (mais elle est décisive) que le droit égal des autres de faire de même. »
- « On pourra remarquer entre autres choses que, dans cette logique, le fonctionnement interne de l’école publique n’a rien de démocratique au premier sens, politique (les élèves ne votent pas pour leurs enseignants ou leurs programmes), mais que des logiques comme celles de l’inclusion ou de la quête d’un bon climat scolaire s’adossent au second sens, social. »
Autre façon de poser la question : « l’école du citoyen ou de l’individu? »
Nécessité pour les acteurs de l’Education d’avoir une « philosophie de valeurs » et de « penser au-delà » du disciplinaire : adopter une « posture professionnelle, une éthique et une déontologie », « transmettre la citoyenneté » , « respecter les personnes, les élèves, favoriser l’égalité des chances »
- « connaître l’histoire de l’école républicaine » pour « comprendre les racines d’un métier de l’humain dont l’objectif principal est d’émanciper intellectuellement et culturellement de jeunes individus, pré-citoyens désireux de s’engager et d’agir dans la cité. »
- « avoir des connaissances juridiques »
- « connaitre les textes institutionnels, les programmes scolaires, le parcours citoyen et le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, qui vise à former des personnes et des citoyens (domaine 3) »